Maryvonne LAMBLARDY, devenue MOUCHET par son mariage, n’a pas vécu longtemps dans notre commune, ses parents ayant déménagé peu après la fin de la guerre. Cependant elle est attachée à ces lieux et y possède une maison, au Rohu, où elle passe quelques mois en été.
Dès le début de notre entretien elle prévient : « Je m’appelle LAMBLARDY avec un Y à la fin, par suite d’une erreur d’un employé d’état-civil, mais le nom de la famille est LAMBLARDIE. J’y tiens parce qu’un de mes ancêtres, ingénieur et directeur de l’Ecole des Ponts et Chaussées a fondé l’Ecole Polytechnique avec Monge. »
NDLR : Jacques-Elie LAMBLARDIE (1747-1797) ingénieur, Directeur de l’Ecole des Ponts et Chaussées, a été, avec MONGE notamment, l’un des quatre fondateurs de l’Ecole Polytechnique, créée en mars 1794 par décret de la Convention sous le nom d’Ecole Centrale des Travaux Publics, devenue Ecole Polytechnique en 1795.
Maryvonne Mouchet continue :« Je suis née en 1939 à Lorient, mais mes parents habitaient Portivy, mon père, Jean, était de Libourne, il était chimiste et il est venu en Bretagne pour l’iode d’abord à Penmarch , puis à Portivy vers 1929.

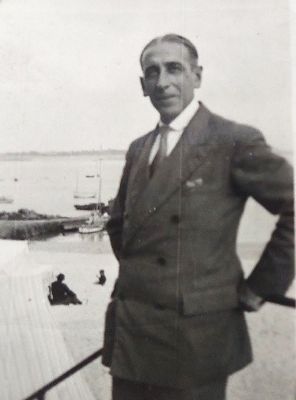
NDLR : « c’est en 1926 que « Monsieur Lamblardy demande à louer l’îlot de Téviec pour brûler le goémon sans incommoder les riverains » (Yann Guimond dans son livre « Portivy-Renaron ») la location ne sera pas possible, donc il construira une usine d’extraction d’iode et de soude ; il faut préciser que l’usine Le Gloahec qui fournissait les mêmes produits avait fermé en 1923.
Mon père aimait les arts, il était musicien, il a fait construire une maison style « art déco » qui a dû choquer un peu, avec toit plat et hublot, près de chez Daniel Guimond. La maison existe encore mais ils ont transformé le toit. L’usine d’iode était à côté mais elle a été détruite.
Mon père avait un tracteur à chenille, ce qui était rare, pour transporter le goémon ; il a servi pour remonter un bateau qui servait de restaurant à Penthièvre, le Thonier et il a aussi servi à remblayer l’isthme après une tempête.
Pendant la guerre mon père a cessé de produire de l’iode. En fait il n’avait pas vraiment une usine, c’était un petit établissement où il a fabriqué de l’eau de Javel et du savon qui manquaient à tous.

Mes parents, pour assurer notre ravitaillement, bien que ne connaissant rien à la campagne, ont acheté une vache, un cochon, des poules et des lapins ; pendant la Poche ma mère arrivait à sortir vers Penthièvre, avec son vélo sous le bras, par la plage de Kerhostin pour aller s’approvisionner. Ça nous a marqués quand maman partait comme ça. Dans les landes derrière chez nous mon frère mettait des pièges et attrapait des lapins de garenne et on les mangeait. Il y en avait aussi sur Nichtilog (NDLR : l’îlot Thinic, Inis Tileuc en breton, d’où Nichtiloc). Ça nous amusait quand les gens allaient sur l’île, ne voyaient pas l’eau remonter avec la marée et se mouillaient les pieds pour revenir.

Ma mère avait inscrit mon frère à l’école communale à Saint-Pierre. Elle aurait voulu qu’il apprenne le breton, mais le Directeur lui a dit : « Il est interdit de parler breton ». Elle se souvenait des dames de Penmarc’h qui parlaient breton et s’arrêtaient quand elle entrait dans un commerce, elle aurait aimé comprendre cette langue. Moi je suis allée chez les sœurs à Keraud. Deux garçons de la communale y venaient à la cantine, je ne sais pas pourquoi. J’ai dû y faire trois ans je crois. Ça faisait loin d’aller à l’école, avec mon frère on y allait à pied en passant par le chemin au pied du moulin, au passage à niveau mon frère allait à droite, coupait là et moi je continuais en passant devant le calvaire.

Et là j’ai une anecdote, les toilettes à l’école étaient dans la cour et n’étaient pas propres, alors moi je me retenais toute la journée et je faisais pipi derrière le calvaire. Le chemin était long et dur avec le vent, mon frère et moi on rêvait d’avoir une petite voiture.
Ce qui était dur aussi c’était de se retrouver seuls en septembre quand les touristes partaient, surtout les jeunes parmi lesquels on s’était fait des copains. J’avais peur en passant près du café avant Keraud à cause des ivrognes. Il y avait une dame très âgée, toute courbée mais très gentille, qui nous donnait des bâtons à goût de réglisse, elle guettait les enfants pour les leur donner. A la sortie de l’école, au Roch, il y avait une maison avec un cerisier, le propriétaire nous faisait entrer dans le jardin et nous en donnait de pleines poches, il était gentil, ce monsieur. Quelquefois quand il faisait beau la maîtresse nous emmenait travailler sur la plage avec nos ardoises, c’était un plaisir. Une fois, mais c’est un souvenir vague, on nous a dit « Prenez vos affaires » et on est allés passer la journée à Saint-Joseph, à cause des bombardements peut-être ?
Avec mon frère on posait des pièces de monnaie sur les rails pour les faire écraser par les trains et faire un rond tout plat. C’était un plaisir d’aller chercher notre grand-mère qui arrivait de Quimper par le train à la station de Kerhostin.
On allait aussi chercher le pain à la boulangerie de Kerhostin , chez Gouzerh. Les pains se vendaient au poids, quelquefois il y avait la « pesée » ( chute de pain lors de la pesée) qu’on avait le droit de manger en rentrant ; à la Libération en 1945 ils ont fait des brioches, c’était bon ! Je n’en avais jamais mangé, je n’ai pas connu non plus le chocolat avant la fin de la guerre.
Je me souviens d’un lavoir, maintenant disparu, pas loin de l’hôtel de l’Océan ; il y a une maison sur son emplacement, sur la route de Portivy à Kerhostin ; c’était avant le camping, dans le virage, on y jouait, il y avait une source, il me semble qu’on avait vu un reste dans le jardin de cette construction.
NDLR : nous avons recueilli sur ce sujet le témoignage de Madame Josette Guffroy dite « Joujou ». Il y avait en effet une fontaine, sans pompe, à cet endroit et deux lavoirs de pierre, l’un pour savonner, l’autre pour rincer ; ils étaient bouchés avec une sorte de bonde, on les remplissait d’eau avec les seaux, on les vidait à la fin de la lessive, en les débouchant et on les nettoyait. L’eau s’évacuait dans une rigole qui partait vers le Varquez (le marais ou le marécage), un terrain communal faisant partie de Kerhostin ; le terrain de la fontaine et du lavoir comme celui du Varquez, où est maintenant le camping ont été vendus sous la mandature de Monsieur Pillet. Les terrains contigus, privés, ont aussi été vendus et bâtis. voir ou revoir l’article de l’entretien de « Joujou «
Pour la fête des Mères comme on n’avait pas de cadeau, on allait cueillir des œillets de dune, sur la Côte sauvage et on les offrait à maman.

Mon père nous avait fait une cabane superbe dans le jardin, il nous avait aussi fait un trou de sable pour qu’on n’aille pas à la plage tout seuls, un espace grand comme cette pièce, avec du sable.
J’avais un ami, Pierre-Yves Lécuyer, je l’appelais Pinpin, qui attrapait des crevettes dans les trous d’eau et les mangeait vivantes, ça me choquait, il ne s’en souvient plus. Je me souviens de l’odeur agréable des giroflées et du genêt dans le jardin, opposée à la mauvaise odeur de l’usine de goémon.
Une ou deux fois par an on allait à la visite chez le docteur Beauvallet, en haut de la rue du Port à Portivy, (NDLR : c’était un ancien médecin militaire) il nous mettait un bâton entre les coudes pour nous redresser le dos, parce que mon père avait tendance à être un peu voûté, et nous renvoyait comme ça chez nos parents, en nous disant « Gardez le, je vous surveille » .
Je me souviens aussi des avions qui volaient bas et des bombes, j’avais peur.
Pour Pâques, comme il n’y avait pas de chocolat, ni de bonbons, les mamans faisaient des bonbons au caramel ; je me souviens, on était chez les Lecuyer, qui avaient l’usine de sardines, Monsieur Lécuyer était âgé et il n’a pas continué l’usine, donc on était chez eux et un avion passe, alors les mamans disent « Oh, l’avion a laissé tomber des bonbons ! », au lieu des cloches c’était l’avion, on est allé chercher les bonbons que l’avion avait laissés tomber!
Une maison à côté de chez nous était occupée par un bijoutier de Lorient, je ne suis pas sûre de son nom (Bourvic), qui utilisait des os de seiche, où il gravait un dessin, puis il y coulait l’or. Après cette maison a été occupée par les Allemands. Une anecdote avec les soldats allemands, une fois le commandant est venu ramener des savons qu’ils avaient pris dans notre buanderie ; une autre fois, mon père avait des bottes de cheval en cuir, ils les ont volées et le commandant les a ramenées.
Durant la guerre, peut-être mes parents avaient-ils peur de la proximité du Fort, la famille s’est réfugiée dans une petite maison appartenant aux Lécuyer, mais il y a eu des bombes, alors mes parents ont tout mis dans la brouette et on a déménagé à Saint-Pierre entre Kermahé et Kerbourgnec, dans une maison appartenant à un ami.
Ma mère a vu Lorient, où habitait sa mère, en feu et elle a aussi entendu les hurlements des Résistants dans le Fort Penthièvre, c’était horrible.
Je me souviens de la Libération, les Américains sont passés rapidement mais ils ont donné du chewing-gum aux enfants près de la boulangerie où on était allés pour les voir.
Pendant la guerre mon père a été appelé à Quiberon pour fabriquer de l’iode pour les Allemands, il a refusé, puis il a essayé de négocier une libération de prisonniers en échange. Les Allemands ont refusé ; on a eu peur que mon père soit arrêté.
Mon père avait acheté beaucoup de terrains, à la bougie, que souvent il n’est pas allé voir. A l’époque on achetait des « sillons ». Maintenant nous les avons identifiés, avec le cadastre, et, c’est amusant, quand on y allait les gens se cachaient. Il en avait loué un, situé à Kervihan, à Monsieur Le Blaye, le loyer était un cageot de pommes de terre qui étaient délicieuses, des grenailles.
Près de l’usine mon père avait fait un potager, il y avait un figuier qu’il était interdit de toucher.
Mon père avait appris la lutherie avec son propre père, il était très musicien, il jouait du violoncelle, de temps en temps on allait à vélo à Carnac où il faisait des quatuors avec d’autres musiciens ; il fallait être sage pendant qu’ils jouaient.

Plusieurs employés, dont le contremaître, étaient morts pendant la guerre. Mon père en a été marqué et il a fermé l’usine ; il est parti pour Bernay, dans l’Eure, où il a repris la lutherie, mais il continuait à s’intéresser à la chimie; il est mort à quatre-vingt-huit ans à Evreux en 1971, ma mère en 1970 à soixante -sept ans.
Je suis partie de Portivy à huit ou neuf ans. Ici on avait beaucoup d’espace pour jouer, à Bernay non, la vie y était très différente, par exemple à l’école des sœurs les pantalons étaient interdits, pas à Keraud, et un autre changement aussi : j’avais l’habitude de dire « dam’oui » , elles me l’ont défendu aussi!!! »
Il faut noter que Maryvonne Mouchet, bercée par l’art dans son enfance, si elle n’est pas devenue musicienne comme son père, a découvert la sculpture et s’y est consacrée, en amateur, avec talent.

